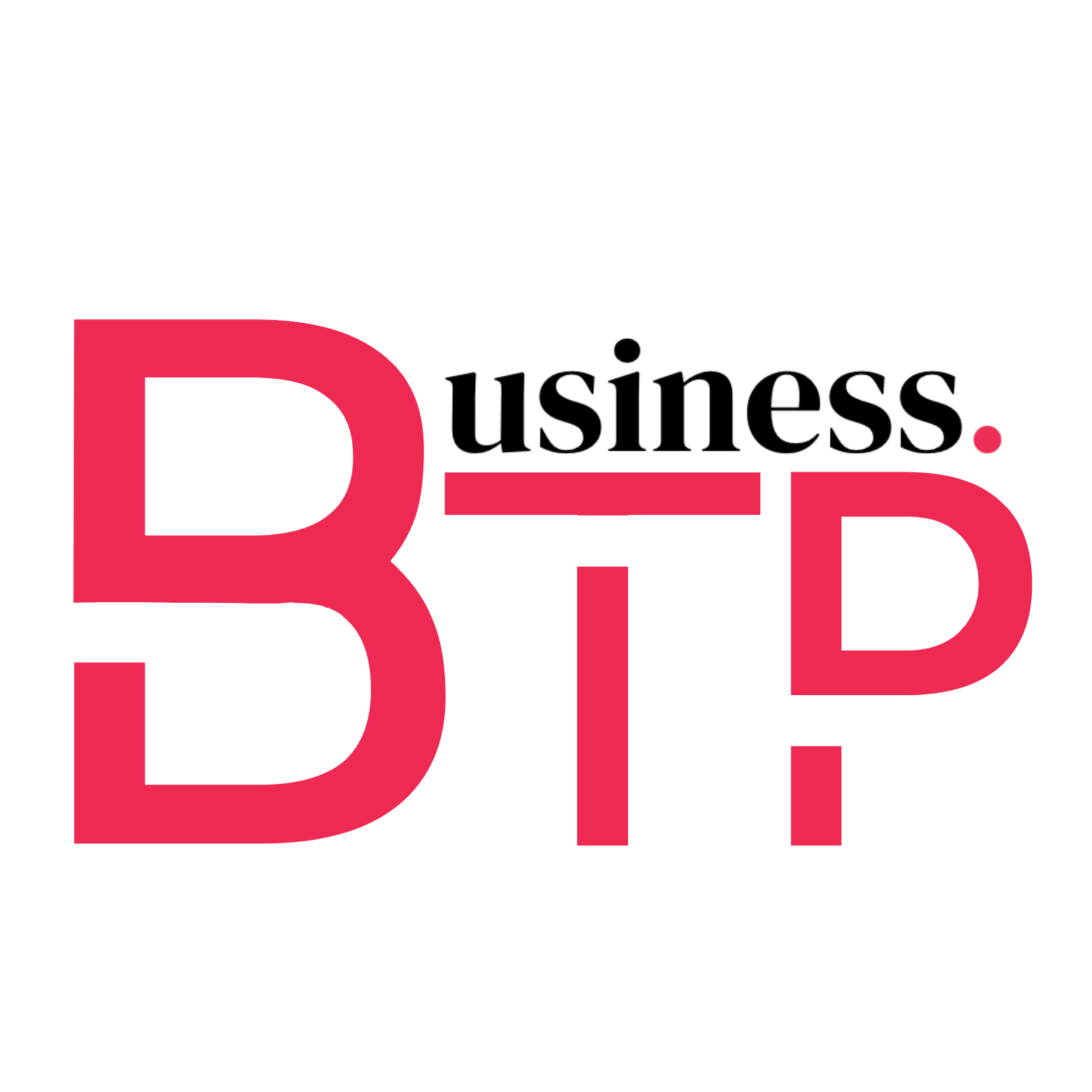Les mouvements de terrain sont le deuxième risque naturel en France. Leur fréquence augmente avec le changement climatique. Face à cette réalité, le Cerema renforce son accompagnement auprès des collectivités pour mieux anticiper, protéger et adapter les territoires.
Un risque majeur, accentué par le climat
En 2024, 76 communes ont été reconnues en catastrophe naturelle (Cat-Nat) à cause de mouvements de terrain. Ce risque, ancien mais bien réel, touche désormais l’ensemble du territoire français et ultramarin.
Ces phénomènes, parfois spectaculaires, résultent de pluies intenses, sécheresses prolongées ou variations thermiques. Ils fragilisent les sols, menacent les constructions et perturbent les réseaux routiers.
Aujourd’hui, le réchauffement climatique intensifie ces aléas. Le sol bouge plus souvent, plus vite et sur des zones de plus en plus vastes.
Comprendre pour mieux agir
Les mouvements de terrain se divisent en deux grandes catégories.
Les mouvements lents : glissements progressifs, affaissements ou retrait-gonflement des argiles (RGA). Ces phénomènes déforment le sol et endommagent les maisons et les routes.
Les mouvements rapides, eux, sont soudains : chutes de blocs, effondrements, coulées de boue. Ils peuvent causer des dégâts considérables.
Selon le BRGM, plus de 65 200 mouvements de terrain ont été recensés en France depuis 1900. Près de la moitié du territoire est exposée au RGA, un risque en nette hausse depuis dix ans.
Les collectivités, premières lignes de défense
Les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans la prévention. Elles doivent connaître les zones vulnérables, informer les habitants et mettre en œuvre des plans de sauvegarde.
Le maire et le préfet coordonnent les actions locales, tandis que les intercommunalités mutualisent les moyens techniques.
Cette approche intégrée s’inscrit dans la politique nationale de prévention des risques naturels majeurs, fondée sur sept piliers : connaissance, surveillance, information, urbanisme, réduction de la vulnérabilité, gestion de crise et retour d’expérience.
Le Cerema, partenaire des territoires
Le Cerema dispose d’une expertise reconnue en géotechnique, bâtiment et infrastructures de transport. Ses équipes accompagnent l’État et les collectivités à chaque étape : diagnostic des aléas, cartographie des risques, simulations numériques et suivi des sites instables.
Elles interviennent également après catastrophe, comme lors des éboulis des Pénitents des Mées ou des glissements dans la Vallée du Gier. Le Cerema agit pour sécuriser les infrastructures, évaluer les dommages et restaurer la stabilité des terrains.
Le centre participe activement au Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), qui prévoit plusieurs mesures dédiées au risque géotechnique, notamment sur le retrait-gonflement des argiles et la prévention en montagne.
Développer la culture du risque
Prévenir, c’est aussi informer. Le Cerema œuvre depuis plusieurs années pour renforcer la culture du risque auprès des élus, des habitants et des professionnels. Il propose des outils pédagogiques, des retours d’expérience et des guides pour aider les territoires à se préparer.
Cette culture collective du risque favorise les bons réflexes et une meilleure résilience face aux aléas naturels. Le Cerema a identifié 12 clés de réussite pour développer ces actions localement : concertation, pédagogie, planification et communication claire.
Agir ensemble pour des territoires adaptés
Grâce à ses expertises et à ses outils innovants, le Cerema aide les territoires à relever le défi climatique. Son objectif : construire des territoires plus sûrs, durables et résilients, capables de faire face aux risques géologiques de demain.
En savoir plus : cerema.fr